Rechercher dans ce blog
7/05/2014
Nous pouvons tenter d’aborder les romans. Ce sont des îles, proches !
Nous pouvons tenter d’aborder les romans. Ce sont des îles, proches mais d’un accès escarpé – des régions qui parfois s’estompent et s’engloutissent dans le brouillard.
On ne sait de quelle façon et de quel côté y accoster. La marée souffle en tempête. Aucun port ne dessine sa rade. On n’aura une chance de toucher au but, d’atteindre la côte qui annonce l’arrière-pays qu’en se fiant, sur des routes sans escale, au flair des contrebandiers.
On craint de s’aventurer seul et l’on se réfère de confiance à des guides. On prononce des noms : Drieu, Morand, Céline. L’application des critiques s’avoue ainsi. Elle explique Nimier par autrui, en oubliant qu’il serait plus intelligent et plus juste de l’expliquer par lui-même. Tout se passe comme si le Grand d’Espagne n’avait pas été écrit. Nous ne pardonnons pas aisément cet oubli. C’est la faute capitale.
A tous égards, le Grand d’Espagne doit être regarde comme le livre-carrefour. Tout converge vers lui. Quand il paraît – au printemps 1950 – il y a un an et demi que les Epées a été publié, et cette sortie a précédé de quelques semaines celle de Perfide. A l’automne, le Hussard bleu lancera la mode, et l’année suivante, à la même saison, ce sera le tour des Enfants tristes et de Amour et néant. Si l’on veut bien considérer qu’Histoire d’un amour (1953) est une espèce de perfection, mais la perfection glacée d’un exercice, on conviendra que Nimier a tout dit en quelques mois. Vers 1950, à l’époque du Grand d’Espagne, son œuvre romanesque est achevée.
Or le Grand d’Espagne est un livre si personnel, si proche du cœur de Roger Nimier, si étranger à toute combine littéraire – panorama d’une sensibilité, d’une intelligence et, à travers elles, d’un temps – qu’il ne laisse place pour aucune ambiguïté. Il est permis de le tenir pour un recueil de textes à la condition de préciser qu’il s’agit d’un recueil de textes d’intimité. Un journal, à sa manière, qui renâcle devant la manière commune : autobiographie spirituelle (l’anecdote, c’est le pittoresque, et Nimier la fuyait) et commentaire d’une œuvre.
Il faut boire à cette fontaine. L’eau des baptêmes, qui oint comme un sacre, y coule. Le roman, chez Nimier, c’est autre chose : une façon de troubler cette eau ou, en tout cas, de la rendre moins claire.
Cette clarté si vive, et disons-le, si sauvage aveuglait. Rien de tel pour garder les yeux ouverts, du moins lorsqu’on est entraîné à farfouiller dans le feu de la neige. Ce qui subsistait, cette limpidité et cette brûlure, c’était, dans le Grand d’Espagne, Nimier tout entier : le songe de lui-même et du monde.
Le songe ne s’est pas évanoui dans les romans : il les baigne toujours, mais en les roulant dans l’écume. Quelque chose de tourbillonnant, et comme d’extérieur, quelque chose d’encombré, une sorte de frénésie qui caracole, une rumeur moins nue, avec des reprises et des alternatives, contribuent à faire lever ces ombres, ghettos de la pudeur bougonne. Il y a des écrans entre Nimier et nous. L’auteur s’abrite derrière des personnages, qui, avec le secours supplémentaire des mots, servent bien ses comédies. Le faux colle au vrai. Il n’est pas facile de les séparer.
On n’utilisera donc qu’avec circonspection les fameuses phrases griffues qui jalonnent les romans. Ce sont souvent des confidences postiches. Trop de critiques distraits, ou malveillants, les ont rapportées comme si elles étaient l’exactitude même, attribuant à Nimier ce qui ne lui revenait pas. Ils ignoraient, ou ils feignaient d’ignorer, que les romans déguisent les aveux du Grand d’Espagne.
Nous ne retiendrons des Epées, du Hussard bleu et des Enfants tristes que ce qui est conforme au Grand d’Espagne. Procéder à ce recoupement, c’est soumettre le Nimier imaginaire au Nimier réel. On a plutôt jusqu’à présent obéi à la démarche inverse. La légende s’en est bien trouvée. Ce fut tant pis pour Nimier et pour nous.
« Prendre le temps, le garder dans son mouchoir pour le montrer aux autres », voilà comment Roger Nimier évoquait son ami Stephen Hecquet. Ce geste de collégien lui convenait parfaitement. Le Grand d’Espagne, c’est cette prise du temps, cette garde du cœur, ce signe de la naissance et des adieux. Une sincérité, une innocence se livraient à nous. Le bavardage de Nimier avait sa voix personnelle il ne mimait pas d’autres accents. Il est donc étrange qu’entre le naturel et la simulation, on ait pris le parti de ne pas choisir le naturel.
L’étrangeté touche à la méchanceté bête, quand on conserve présentes à l’esprit ces deux observations : d’abord tous les livres de Nimier ont été écrits à la même époque, et ensuite le Grand d’Espagne est le seul d’entre eux qui n’emprunte rien au romanesque. Par la force des choses, l’œuvre de Roger Nimier ne se dispersant pas, mais se ressentant autour d’un foyer unique, tous ces livres s’imbriquent. On dirait des tables gigognes.
On le saura mieux lorsque sera publiée la correspondance de jeunesse de Nimier. Ce que Jean Namur a bien voulu en confier – quelques lettres de 1945 pour le numéro d’hommage d’Accent grave – creuse en nous une curiosité inextinguible et une faim que l’on ne rassasie pas hélas ! Ce goût du malheur et du bonheur mêlés, ces chemins solitaires et ces figures amicales qui conspirent contre eux, ce parfum des affections condamnées, ce dédain et cette douceur comme une escapade, cet appétit de perfection et ce qui le contrarie, c’est la part du Grand d’Espagne enfouie dans le Hussard bleu et dans les Enfants tristes. Ecoutez. « Nous sommes partis du stade le plus bas, la solitude. Et peu à peu nous avons appris à vivre en société, puis à être élégants ; puis l’imbécilité, l’importance. N’empêche il y aura derrière nous quelques années volées. Les grands péchés, ce sont la timidité, l’indécision. Combien se privent de leur bonheur par ces lâchetés ! ». Le Grand d’Espagne (« Les défauts que je vous recommande sont la frivolité, la discrétion, la pudeur, la débauche et un peu de vieillesse, mais sans excès. Pourtant, c’est bien l’excès qu’on vous reprochera. La bonhomie est la vertu du siècle. Au moment où l’Histoire gouverne tous les cœurs, le mot d’ordre semble être de ne pas faire d’histoire ») s’adosse au Hussard bleu (« Nous devons beaucoup à nos amis morts, nous leur devons tant d’années volées. Alors ce qu’ils nous demandent à voix basse, il faut le faire tout de suite »).
Voilà un test, et assez probant. Un ouvrage à l’aiguille, point par point, mot à mot. On ne passe pas du Grand d’Espagne au Hussard bleu d’un monde à un autre ; on n’y fait pas la connaissance de deux auteurs distincts. C’est le même univers ; c’est le même système nerveux qui le régit ; c’est la même saccade des mots qui l’ébranle. Nous n’apercevons qu’une seule différence, et c’est la différence même des genres : le Grand d’Espagne commente sans porte-parole de rouerie ce que les romans représentent avec des acteurs qui se relayent ; il trace une géographie intellectuelle alors que dans les romans cette intelligence, allée à l’imaginaire, invente une géographie mythologique. D’un côté, c’est Nimier au réveil, et qui n’en finit pas de s’ébrouer dans ses rêves comme dans ses colères ; de l’autre c’est Nimier pomponné, prêt pour un dîner de têtes. On lit comme il faut les romans quand cette poudre, qui est une poudre aux yeux, n’empêche pas de deviner le visage véritable. La peau de fortune de Nimier, c’était l’infortune de son romanesque.
Pol Vandromme, Roger Nimier
Repris à partir de www.oragesdacier.info
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

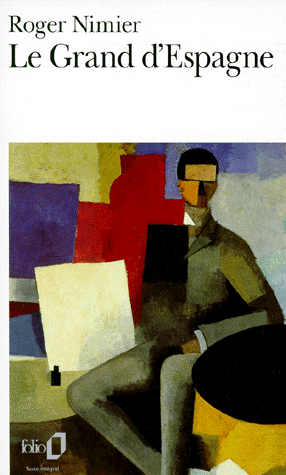
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire